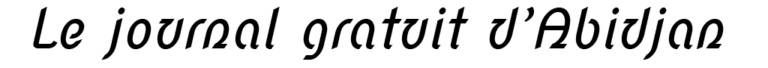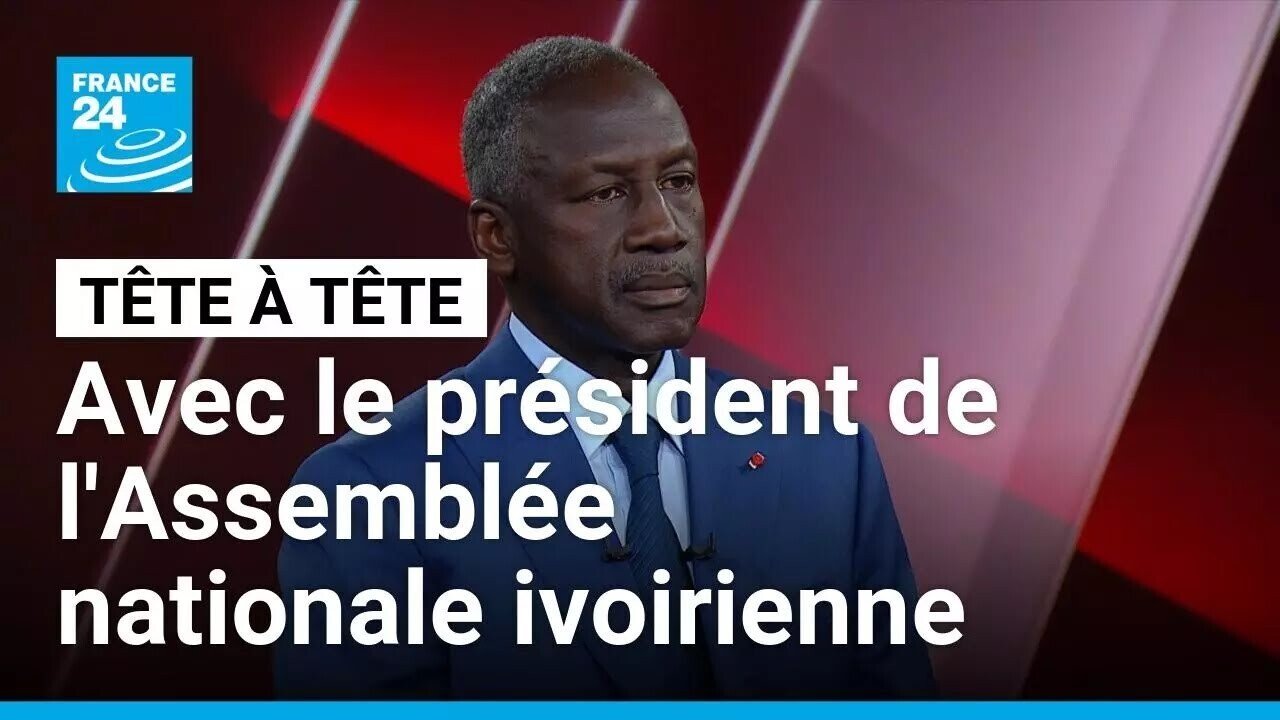Retranscription détaillée de l’Interview d’Adama Bictogo sur la chaîne française France24 diffusée le 10 juillet sur Youtube. Lors de l’entrevue, Bictogo s’est déclaré candidat du RHDP
[Musique] Bonjour et bienvenue en tête à tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Adama Bictogo. C’est le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, le maire de la commune de Yopougon et un poids lourd du RHDP au pouvoir, monsieur Bictogo. Bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, on va évidemment parler de l’élection présidentielle du 25 octobre. Le président Alassane Ouattara a été désigné candidat à cette présidentielle par votre parti lors du Congrès, le 21 juin, mais il n’a pas encore confirmé si oui ou non il allait être candidat. Il a déclaré « Je vous ai entendu, je prendrai dans les prochains jours une décision après mure réflexion. On est plus qu’à quelques jours, on est à des semaines. Que se passe-t-il ? Est-ce que vous pensez que le président ne va pas y aller ?
Bictogo: Merci. Je voudrais d’abord saluer la grande mobilisation des militants qui s’est exprimée non seulement pendant les précongrès, pendant le Congrès, le 21 juin et le RHDP a fait la démonstration de ce que le RHDP est le premier parti de Côte d’Ivoire. Ce congrès avait deux points essentiels. Le premier point, c’était donc de désigner le candidat, le président Alassane Ouattara comme président du parti parce que c’était le renouvellement des instances. Ce qu’il a accepté donc il a été élu président du parti à l’unanimité. Le deuxième point euh, c’était donc de présenter le candidat président du RHDP comme candidat aux élections présidentielles d’octobre 2025. Effectivement sur ce point le président de la République, son excellence Alassane Ouattara a demandé que nous lui accordions quelques jours. On est à plus que quelques jours. Et et il faut noter aussi que dans son discours, il a dit « Je suis le président de tous les Ivoiriens ». Je veux donc vous faire noter que la date limite des dépôts des candidatures, c’est le 26 août. Donc je crois que quelques jours, on peut même aller jusqu’au 20 août pour qu’il s’exprime. Donc je ne pense pas que le temps soit un problème aujourd’hui en ce qui concerne donc l’annonce de sa candidature.
Vous êtes sûr vous qu’il va être candidat ?
Bictogo: Mais il n’y a pas de doute, l’ensemble non, il n’y a pas de doute. L’ensemble des militants, aussi bien pendant le précongrès et le Congrès, ont comme une seule voix réclamé sa candidature et cette candidature, elle repose sur des faits. De 2010 à 2025, le président Alassan Ouattara a transformé de façon structurelle l’économie de la Côte d’Ivoire. Le président a transformé la Côte d’Ivoire. Donc les fondamentaux au plan économique sont tels qu’aujourd’hui nous RHDP avons pensé que nous devons nous installer dans la continuité, la stabilité pour une paix durable et un développement. Vous savez, sans développement, il n’y a pas de paix, mais sans paix, il n’y a pas de développement.
Pourquoi ? Pourquoi ce point d’interrogation ? Est-ce que vous vous posez la question est-ce qu’il ne va pas y aller ? Est-ce qu’il y a en effet la possibilité qu’il n’y aille pas ? Et que se passe-t-il dans ce cas-là ? parce que lors de scrutin précédent, il avait préparé sa succession. Là, il n’y a personne.
Bictogo: Oui, mais il n’y a pas de doute. En ce qui me concerne, si vous voulez mon avis personnel, il va y aller. Oui. D’accord. Je peux vous assurer que monsieur Alassane Ouattara sera donc candidat, bel et bien candidat en octobre 2025.
Donc si jamais vous vous trompez, qu’est-ce qui se passe ? Ça affaiblit le parti. Ça veut dire que les ambitions vont se déclarer. On parle du peut-être du vice-président, du premier ministre, de Patrick Achi peut-être.
Bictogo: Vous savez euh nous avons un parti organisé. Le président pas pour ça. Voilà. Si si si si si si. Le président a été élu président du parti. Il y a un parti et vous venez de citer des personnalités. Ce sont des personnalités effectivement qui comptent. Et le président l’a toujours dit, il dispose en son sein des cadres, des haux cadres. Au moment venu, vous savez, nous avons un président qui se projette toujours. Je reste convaincu que le président en lui-même dispose en son sein par lui-même les différents scénari. Donc moi, je n’ai pas d’inquiétude quant à toute possibilité qui pourrait s’offrir donc à au RHDP, mais je peux vous garantir et vous assurer que le président sera bel et bien candidat en octobre 2025.
Bictogo: Si jamais votre diagnostique est faux, est-ce que vous vous pourriez imaginer une candidature, vous l’excluez totalement ?
Bictogo: Si jamais le président venait à ne pas être candidat, j’appartiens au RHDP et depuis près de 32 ans, j’ai toujours été un homme de mission. Le président m’a toujours confié les missions et je les ai toujours accompli. L’une de ces missions, c’est bien la mairie de Yopougan, quartier que j’ai jamais habité et qui répondait plus de l’opposition. Fief de Laurent GBabo. Mais le président m’a envoyé en mission et j’ai gagné. Il m’a envoyé en mission à l’Assemblée nationale, j’ai été élu à 99 %. Donc à chaque besoin, je réponds à ces appels. Si le président considère que pour telle pour ou telle mission, je suis l’homme de la mission, parce que la compétence ne vaut que par l’enjeu et le contexte. Si le contexte et l’enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Donc je suis un homme de mission au côté du président Alassane Ouattara.
Le contexte électoral est tendu. Euh les principaux candidats Tidjane, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ne peuvent pas être candidats. Cela crée beaucoup de frustration chez eux et d’inquiétude dans le monde parce qu’on se dit cette élection ne va pas être inclusive et pourrait à nouveau créer des tensions, voir de la violence.
Bictogo: L’histoire de la Côte d’Ivoire à ce niveau-là est évidemment préoccupante. Est-ce que ce sera une mauvaise élection en raison de l’exclusion des principaux candidats ? La qualité de lection, elle est fondée sur le taux de participation d’une part la transparence de l’élection pour l’annonce du de résultat fiable. Donc il faut dissocier euh la qualité de l’élection et de ceux qui doivent y participer. Vous avez cité ceux qui ne participent pas. permettez que, en tant que président de l’Assemblée nationale, je sois respectueux de la séparation des pouvoirs. Tous ceux que vous avez cités, certains sont frappés d’interdiction de faire valoir leur droit civique. Et pour Tidjane Thiam, parce que pour les autres Soro, Blé Goudé, le président Gbagbo, c’est ce que je viens de dire. En ce qui concerne Tidjane Thiam, c’est la loi de 1961. Donc ce n’est pas une loi dédiée, c’est une loi qui existait, qui n’a jamais été utilisée, sauf pour lui. Ben, qui a jamais été utilisée, il se trouve c’est un peu comme certaines maladies. Vous savez, parfois il y a des gens qui ont des maladies et qui représentent peut-être 1 % euh dans la population mondiale. Mais vous comprenez bien la perception que ça -donne- on a l’impression qu’on élimine et que la perception est une chose, la loi est une autre.
Ça ne vous inquiète pas?
Bictogo: On ne peut pas être un homme politique sans tenir compte de la perception. Mais ce que je veux dire, le président Alassane Ouattara, ni le gouvernement ni le pouvoir en place n’est à la base de l’impossibilité du président du PDCI-RDA à s’inscrire sur la liste électorale.
Lui dit le contraire.
Bictogo: Non, il s’est trouvé qu’il a été frappé par la loi de 1961. loi qui a été prise du temps du président Houphouet-Boigny dont il est le petit-fils. Donc je considère qu’accuser le gouvernement et le président Alassane Ouattara d’exclusion de certains candidats, je dis non, il y a le respect de la loi. Maintenant, pour terminer, je voudrais dire que ce président peut apprécier si le contexte politique impose que il y ait parce qu’il y a une forte tension pour l’UR c’est pas le cas. Moi, je ne vois pas de tension en Côte d’Ivoire, je ne vois pas de grandes préoccupations. Ce que je veux dire, c’est que si naturellement le pays se retrouvait dans une situation de tension très forte en tant que président de la République, il a bâti pendant ces 15 ans la transformation de la Côte d’Ivoire autour d’éléments fondateurs tels que la paix, la stabilité, la cohésion sociale. Donc il n’y a pas meilleure personnalité plus que le président pour donc maintenir cette stabilité et la paix. Donc voilà.
Dernière question, vous êtes ici en France. L’Assemblée nationale française a voté à l’unanimité un texte de loi prévoyant la restitution du tambour parleur qui avait été saisi en 1916 durant la période coloniale. Est-ce que c’est juste un geste ou est-ce que vous pensez que ça va ouvrir peut-être des perspectives pour des restitutions pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique ?
Bictogo: Ouais. Je voudrais d’abord dire qu’à l’occasion de l’Assemblée parlementaire francophone, cette visite officielle a permis donc effectivement de bénéficier, d’obtenir donc ce document juridique relevant donc d’une loi adoptée par l’Assemblée nationale, montrant ainsi que l’excellence des relations entre nos deux pays et entre nos deux chefs d’état a permis donc le retour de ce tambour parlant qui est une symbolique qui montre qu’en fait il y a certes les institutions mais il y a le respect de nos cultures. Il y a ce tambour qui est l’expression d’une des cultures de la Côte d’Ivoire. Donc nous souhaitons effectivement que ce retour de tambour parlant soit donc le début d’une restitution organisée de l’ensemble de tous nos biens culturels qui se trouvent ici en France. Mais je voudrais une fois de plus saluer cette belle, cette relation que nous entretenons avec la France. Nonobstant les mutations qui se font dans nos pays, il est bon qu’en plus donc de l’excellente relation, que nous puissions revisiter certaines de certains supports qui fondent nos relations. Et cela va avec l’évolution des choses. Nous sommes dans un nouvel ordre géopolitique, dans un nouvel ordre politique mondial. Donc, il est plus que bon que nous renforcions le multilatéralisme, que nous renforcions donc le bilatéralisme. Et comme vous le savez, la Côte d’Ivoire et la France entretiennent des relations historiques culturelles très soutenues et nous pensons que pour la France et pour la Côte d’Ivoire, pour les générations à venir, il est bon souvent à chaque fois, chaque dizaine d’années de revisiter certaines conventions pour que justement nous puissions épouser le nouvel esprit qui habite donc l’ensemble des générations des deux peuples.
Adama Btogo, merci beaucoup ed’être venu sur le plateau de France 24 et merci à vous d’avoir suivi cette émission sur nos antennes. [Musique]
Lire aussi sur la Côte d’Ivoire